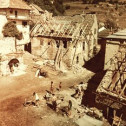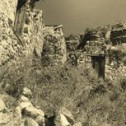1954
D’enthousiasme en enthousiasme, Georges et Toine, comme dit plus haut, décident d’unir leurs efforts, tant financier que technique, pour reconstruire Peyresq, dans le but d’y réunir des étudiants, artistes et scientifiques en un foyer d’humanisme rayonnant.
Pour encourager et réaliser le projet de bâtir ce foyer d’humanisme et international, les pionniers, Georges et Toine, jugèrent nécessaire de constituer une ASBL, dénommée Pro Peyresq, ayant pour tâche de guider la reconstruction du village afin de converger vers les objectifs fixés. Ce projet fut efficace et le village reconstruit en témoigne aujourd’hui. C’est ainsi que sur la place de Peyresq, assis sur le vieux banc de pierre accroché à l’église, les statuts de l’Association Pro-Peyresq furent mis au point sous un lumineux soleil de Pâques 1954.
Evénement que nous fêtons en cette année 2004, où “l’espérance d’hommes venus d’ailleurs a rebâti ce village en ruines, lorsque les terres ne parvenaient plus à nourrir ses enfants”.

Le groupe d’étude de l’élaboration des statuts Pro Peyresq.
A gauche : Toine; à l’extrême droite : Georges; au centre : Mady et Jane.
L’acquisition des ruines et des maisons aux toits effondrés apparut rapidement comme un impératif urgent. Nos pionniers donnèrent le coup d’envoi.
Le président Toine Smets fut un mécène persévérant. Il permit entre autres l’achat des premières maisons, dont il fit don par la suite à l’Union des Anciens Etudiants de l’Université Libre de Bruxelles en échange de bourses de séjour en faveur des étudiants participant à la reconstruction du village de Peyresq, ce qui contribua à la réussite du projet.
Il dota de plus l’Association d’un « Fonds Sophocle », lui permettant l’achat et l’aménagement des maisons, Sophocle, Erasme (droit), A.Sc.Br. (sciences), Baden-Powell, le déplacement de la bergerie de Noëllie située sous Sophocle, l’achat de la première et seconde camionnette, etc.
Nos deux pionniers furent rapidement suivis par les étudiants dynamiques qui entraînèrent leurs groupements: de l’Université de Bruxelles d’abord, de Gembloux, de Mons, de Liège, et l’Association des Tables Rondes. L’Académie de Bruxelles rejoignit les étudiants de l’Académie de Namur, présents dès le départ.
Si bien que Peyresq trouva sa formule de survie, une fédération de groupes. Chaque groupe étant propriétaire de sa ruine, la relevait à son rythme, à condition de suivre les conseils avisés de son architecte et de son maçon, René Simon à qui ce livre est dédié.
La reconstruction de Peyresq
Il ne faut pas s’imaginer que les éléments vitaux pour le fonctionnement du village de Peyresq et sa reconstruction furent faciles à obtenir. Toute la correspondance de 1954 à 1956 du Maire, Simon Giraud, successeur de Joseph Imbert, avec les autorités et avec Georges et Toine, nous montre les démarches difficiles qui ont dû être effectuées.
Le point de départ était, sans aucun doute, l’électricité mais à l’époque, Peyresq, village presque inconnu, quasi inhabité et plus en ruine que debout, n’était pas rangé dans les villages prioritaires.
C’est grâce à la compréhension, à la collaboration du Préfet, du Sous-Préfet, du Conseiller général, du Président des Alpes-de-Haute-Provence, qui tous ont cru au projet humaniste de reconstruction du village de Peyresq, qu’après bien des mois et une avance de fonds substantielle de nos pionniers et de la commune, que l’ingénieur chargé de l’installation de la ligne électrique passa à l’action.
Finie l’ère de la lampe à pétrole et des bougies. Mais pas encore d’eau potable, ni d’égouts à Peyresq. Ce fut là une bataille d’une année supplémentaire et avec l’accord du Conseil Municipal l’introduction de la demande de prêt pour ces travaux avec en plus l’appui du Ministre des Affaires Etrangères Belges auprès de son homologue français de l’Agriculture.
Enfin, après un nouvel apport financier de nos pionniers et de la commune, pour l’eau et les égouts, le projet se concrétisa début de l’été 1956, en même temps que se réalisait la route départementale.
Le manque de commodités et le retour à la vie de la vraie nature n’ont pas empêché la mise en œuvre des travaux de reconstruction où le rythme était d’autant plus rapide qu’il fallait réaliser le toit dans la maison où on logeait, chambres, dortoirs sans électricité, sans eau courante, sans égouts, sans contraintes ? Le paradis quoi !
L’unique sanitaire était constitué par un édicule à trois panneaux ouvert sur le vide et l’horizon, équipé d’un drapeau rouge articulé afin d’en signaler l’occupation !
La reconstruction fut une époque exaltante, au point que chacun emportait la nuit ses outils pour être certain de les retrouver le lendemain?
Notre reconnaissance ne pourrait être assez grande à l’égard des autorités locales et départementales, pour leur soutien et leur encouragement pour cette entreprise hors norme, difficile à imaginer dans sa réalisation : nous les en remercions et n’oublierons jamais l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Pierre Lamby, architecte, s’attacha avec un immense courage à la tâche de la reconstruction de Peyresq. Que dire des difficultés rencontrées en regardant certains coins du village et ses amas de ruines…
Son but : rendre à ces ruines une âme, recréer un village, retrouver sous les décombres le vrai visage de Peyresq.
Les Etudiants Bâtisseurs
A vingt ans on a envie de donner un sens à sa vie. Quel plus bel objectif que de participer à la reconstruction d’un village abandonné dans le but d’y réunir des étudiants, des artistes, des scientifiques en un foyer d’humanisme rayonnant.
L’idée lancée fut aussitôt suivie, mais dans ce village aux murs sans toit, les logements étaient rares et même inexistants.
Aussi l’équipe de départ en 1953 fut-elle réduite à 8 étudiants, tous de l’Académie de Namur. Des durs n’ayant pas peur des déblais, ni des crottins de mouton.
Les premiers travaux permirent de sauver presque intégralement quelques-unes des plus belles maisons. Celle de l’Union des Anciens Etudiants de l’Université Libre de Bruxelles, au coin de la place de Peyresq, ainsi que la maison dénommée par la suite Fabri de Peiresc.
Ces deux maisons permirent de disposer de logements supplémentaires, et il a été ainsi possible d’augmenter l’équipe à 30 courageux étudiants bâtisseurs.
Il en fallait du « courage » pour faire face uniquement à la force des bras à ces rudes travaux de déblais et de béton fait main.
Si cette reconstruction, difficile à imaginer, a été menée à bonne fin, nous le devons à ces étudiants bâtisseurs, à l’architecte et au maçon, mais aussi à toutes les bonnes volontés animées d’humanisme et gonflées d’enthousiasme : secrétaire, trésorier, économe, chefs de chantier.
C’est bien là, la raison profonde qui depuis l’origine a déclenché la longue suite de grands et petits miracles qui ont permis à Peyresq de renaître, de vivre et de rayonner.
L’équipe des étudiants bâtisseurs composée de volontaires, payant leur séjour et offrant leur travail avec enthousiasme, fut renforcée par quelques professionnels, puis grâce à la transformation du chemin muletier en route départementale, il fut possible de faire arriver quelques machines : une petite bétonneuse et un engin de transport qui relaya brouettes et pelles.
L’acheminement des matériaux dans le village en fut ainsi facilité.
Notre architecte, Pierre Lamby, nous explique comment pour les étudiants bâtisseurs le manque de toit au-dessus des dortoirs (et surtout le mauvais temps) aiguillonnait l’avancement du travail de couverture. L’atmosphère pionnière des chantiers était spécialement entraînante.
Levée à 6 h., l’équipe des étudiants bâtisseurs gagnait le hangar où depuis 5 h, déjà, s’escrimait à rainurer les planches de toiture, un personnage extraordinaire, un petit homme, sec comme un sarment de vigne, un charpentier espagnol, ne connaissant de la langue française qu’une seule expression, qu’il ressortait à tout bout de champ : « Putain de planche! ». Aussi les étudiants bâtisseurs l’avaient-ils baptisé de la sorte.
A 8 h. : transport des planches rainurées au travers du cimetière, jusqu’à pied d’œuvre.
A 10 h. : pause bol de lait de chèvre sur les marches de l’église.
Ensuite, sauf pendant les suspensions « repas », les planches n’arrêtaient pas d’être acheminées sur le toit où « Putain de planche », malgré trois doigts manquants à la main droite, réalisait rapidement le placement au-dessus de l’aplomb des paillasses. Et ainsi de suite tant que le soleil permettait d’y voir clair.
Naturellement, à situation exceptionnelle, effort exceptionnel de nos étudiants bâtisseurs.
Mais la lutte était inégale, car malgré les efforts surhumains des étudiants bâtisseurs de Peyresq, les hivers accentuaient la dégradation du village et des maisons abandonnées.
Chaque ancienne construction était de plus en plus menacée.
Le poids des neiges sur les toitures non entretenues, les faisait s’écrouler, entraînant fermes et tirants.
La maçonnerie, découverte, ne tardait pas à suivre par pans entiers. Bientôt il ne fut plus question de réparer ou de sauver, mais d’araser pour reconstruire.
Devant l’importance de ces travaux, les deux mois d’effective activité, au regard des dix mois d’abandon total, réclamaient une organisation toute différente des chantiers.
Nos étudiants bâtisseurs, au lieu d’élever les constructions par assises horizontales, furent obliger de travailler par phases verticales, réalisables dans le délai des deux mois d’activité de chantiers et absolument protégées, c’est-à-dire s’arrêtant à la finition de la toiture.
Cette façon de procéder a heureusement permis l’occupation immédiate de locaux très utiles pour les logements, les réunions, la cuisine, les repas et le départ des futures activités de Peyresq : culturelles et scientifiques.
Ainsi une trentaine de maisons furent-elles reconstruites en vingt-cinq à trente ans, mais il y aura toujours des travaux en cours à Peyresq.
Plus de 6.000 étudiants bâtisseurs ont apporté leurs efforts à la reconstruction du village de Peyresq, efforts couronnés de succès par la réalisation de ce lieu unique d’échanges et de rencontres.
Merci aux étudiants bâtisseurs, à notre architecte Pierre Lamby, et au dévoué maçon René Simon. Un village était mort, il revit !
C’est la somme de tous ces courages, de toutes ces initiatives, de tous ces dons, de tous ces rêves, de toutes ces solidarités, de toutes ces amitiés, de tous ces apports humanistes, qui a fait Peyresq.
Au début de la reconstruction du village de Peyresq, Pierre Lamby, architecte, rencontre au cours d’une randonnée le grand écrivain Jean Larteguy, en compagnie de Philippe Lamour, auteur des Centurions et président de la Commission Nationale pour l’Aménagement du Territoire dans ces Basses Alpes. Aussitôt s’engage la discussion sur le passé et le devenir du pays.
« Non, l’exode rural n’est pas toujours une catastrophe », déclare Philippe Lamour au grand étonnement de ses interlocuteurs.
Et d’insister en précisant : « l’abandon par les paysans des terres qui n’étaient plus rentables représente pour le pays un grand progrès économique et social.
La surpopulation que ces régions connaissaient encore il y a un siècle maintenait un mode de vie inhumaine pour une production sans valeur. Si étrange que cela puisse paraître, ces pays sont devenus riches en se dépeuplant.
La seule richesse, l’herbe, est consommée sur place par les troupeaux transhumant pendant les quatre mois d’été. L’abandon des villages à cette altitude, mais c’est un progrès …
En 1950, il n’y a plus ni cultures, ni pratiquement de villages, plus de vains efforts, ni de dépenses perdues. Le mouton gagne sa vie lui-même en se déplaçant pour aller consommer aux moindres frais les seules richesses de ces pays. La dure loi de l’économie a rendu rentables ces territoires qui jadis n’avaient créé que de la misère, et formule Philippe Lamour, l’idéal serait d’apporter à ces vallées et villages un renouveau culturel. »