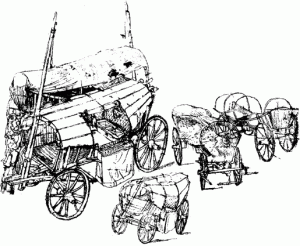1913
Le printemps est bien là et, avec lui, toutes les activités extérieures peuvent reprendre vie au village de Peyresq. Chacun remplit son rôle, en ces premiers beaux jours de 1913 : rôles immuables depuis tant et tant d’années ! Les hommes ont pour mission de rebâtir les murettes en pierres sèches qui retiennent les « faisso » (terrasses de terre) et qui se sont plus ou moins écroulées sous le poids de la neige. Ces « faisso » sont souvent des parcelles minuscules, découpées dans les versants de la montagne, épousant les courbes de niveau : sur ces bandes de terre, on sèmera du blé et du seigle sur les plus grandes et on transformera les plus petites en jardins.
Quand les hommes ont fini de rebâtir les murettes, ils appellent les habitants pour les aider à remonter la terre du bas du champ vers le haut, dans des hottes ou des paniers. Les femmes, elles sont occupées par d’autres tâches, tout aussi pénibles. Certaines sont en train de laver le linge de l’hiver, dans l’eau glacée de la fonte des neiges.
Elles s’interrompent régulièrement pour battre des mains et tenter d’atténuer la morsure du froid. Elles songent à l’été où elles pourront aller faire la lessive près de la source du Ray: certes, il leur faudra marcher dans des pentes raides avec leurs grands paniers pleins de linge et de draps, mais, là au moins, elles ne souffriront plus du froid; elles emporteront chacune quelques morceaux de pain et un peu de fromage, quelques olives.
A la première foire du mois de mai, les Peyrescans descendent maintenant à Annot avec leur char à banc, ils peuvent ainsi y aller en cinq heures, par le nouveau chemin routier, qui a été empierré en 1905. Que de discussions au sujet de l’aménagement de cet ancien sentier muletier, travaux qui allaient coûter 1800 F à la commune! Pourtant, dès que le nouveau chemin vicinal fut ouvert, la famille, qui s’était le plus vivement opposée à cette dépense jugée inutile, fut la première à acheter un char à banc. Il est vrai que malgré cet aménagement, on restait bloqué à Peyresq pendant de longs mois d’hiver, car le déneigement se faisait aux frais de la commune.
A cette foire de mai, on ira acheter le cochonnet à engraisser, qu’on ramènera sur le char à banc. L’animal sera bien nourri jusqu’à la mi-décembre avec de la bouillie d’orties, du petit lait, des pommes de terre, des épinards sauvages qu’on cuit dans une grosse marmite sur le poêle – cette marmite à fond plus étroit s’encastre dans le poêle quand on enlève un ou deux ronds. Et puis les femmes vont acheter quelques bouts d’étoffes pour être belles les jours de fête. Certaines, cependant, à cause de leur pauvreté ou encore de l’avarice de leurs maris, n’iront pas faire leurs achats d’étoffes à la foire : le colporteur de St-André les leur apportera à l’auberge de Peyresq et, en cachette, elles iront par une petite ruelle étroite échanger quelques poignées de grains contre un bout de tissu et quelques articles de mercerie. D’ailleurs, la première grande fête, c’est pour très bientôt et, au retour d’Annot, on entend les jeunes Peyrescanes fredonner quelques jolies chansons, se réjouissant d’avance pour le grand pélerinage de Notre-Dame de la Fleur.
Ce lundi de Pentecôte, les habitants de Peyresq, 1 ou 2 membres par famille, descendent à pied par le sentier de la Colle à la chapelle de la Fleur, où ils attendront à la gare la longue procession venant de Thorame-Haute. Chacun a mis son plus bel habit pour aller vénérer une statue de la Vierge, telle qu’elle serait apparue à de jeunes bergers, une rose à la main. De toutes les vallées alentour, les montagnards affluent pour accompagner la Vierge dans sa chapelle estivale de la Fleur, où elle restera jusqu’à l’automne ; à ce moment-là, elle regagnera l’église paroissiale de Thorame-Haute. Après la procession chantée, les pèlerins s’égaient dans les champs où ils mangent le bon pique-nique apporté dans un panier. Des marchands ambulants, s’installent autour de la chapelle et, parfois, on se laisse tenter par quelque objet de première nécessité. Le soir, en bandes, les Peyrescans remontent vers leur village, contents d’avoir gagné un peu leur salut.
Bientôt, on va célébrer l’arrivée de l’été, en allumant le grand feu de la St-Jean. Certes, on économisera le bois, mais la flamme s’élèvera assez haut pour que les bergers transhumants en voient, de loin, la clarté !
Voici les premiers troupeaux transhumants, en ce lendemain de la Saint-Jean : ils resteront dans les pâturages jusqu’à la Saint-Michel. Mais avant de faire la dernière étape qui les conduit à la cabane de l’estive, les troupeaux et leurs bergers passent une nuit à Peyresq, sur la place même du village. Au petit matin, lorsque les bêtes ont fini de s’égrener, par les ruelles, vers les collines, les femmes sortent de leurs maisons, divisent la place et ramassent, avec la pelle et le balai, le précieux fumier pour le jardin. Malheur à celle qui oserait dépasser les limites imposées !
Au moment de la transhumance, le village semble renaître, avec le retour des Peyrescans qui ont passé l’hiver au loin et avec l’arrivée des bergers de Basse-Provence, qui ont loué des montagnes pour leurs troupeaux.
En ce dimanche de juillet, Jean garde son troupeau au-dessus de la Grau. Au fond de sa poche de veste, il tâte le galet ovale qu’il avait ramassé dans ces quartiers, il y a presque cinquante ans. Personne, à ce jour, n’a su lui traduire la phrase qu’il y avait si soigneusement gravée. Il regarde passer une bande de jeunes gens du village qui vont à la fête de la Sainte-Elisabeth, à La Colle ; à la fin du mois, ils iront fêter saint Jacques à Méailles : il faut bien profiter de la belle saison pour aller rencontrer les autres. Ce matin, Jean a vu Joseph et Gaspard qui partaient à la pêche à la truite dans le Ray, tandis que Catherine et Jean-Baptiste grimpaient, de l’autre côté, sur le sentier du Courradour, tirant le mulet bâté: ils vont sans doute voir le père qui garde à la Cabane-Vieille et lui apporter quelques provisions de nourriture et de tabac.
En cet été 1913, la fête du 15 août est à nouveau appelée « Nostro-Damo » en l’honneur de la Vierge Marie. Les jeunes du village ont garni la place : arbres et guirlandes de buis donnent un air de fête à Peyresq.
Le matin du 15 août, tout est fin prêt : la viole est installée sur la place, devant la mairie et les Peyrescans ont revêtu leurs habits du dimanche pour accueillir les parents et amis venus des villages voisins. Le curé a mis la magnifique chasuble brodée de fils d’or. Dans l’église, qui s’avère petite pour contenir à la fois les habitants et leurs invités, chacun s’asseoit à la place qui lui est communément réservée et qui était payée 1 franc l’an : les femmes dans la nef et les hommes autour du chœur et dans la tribune du fond de l’église. Après la grand-messe, les fidèles s’égayent dans le village au son des cloches et l’on va prendre le repas de fête en famille : on mange de la tête de veau et, au dessert, la traditionnelle « crème » (îles flottantes). Vers trois heures de l’après-midi, on se retrouve encore dans l’église pour les vêpres. A la fin des vêpres, la communauté part en procession jusqu’à l’oratoire de Saint-Restitut : en tête, l’enfant de chœur porte la lourde et antique croix ; derrière, une jeune fille tient bien droite la bannière de la Vierge; ensuite, viennent les hommes qui portent sur leurs épaules saint Pons et Notre-Dame des sept douleurs, tenant les quatre montants du dais qui abrite les statues : honneur suprême pour ces hommes qui remplissent leur mission avec dignité.
Enfin, derrière les statues, arrive l’abbé, la belle chape brodée sur les épaules et tenant l’ostensoir, et, toute la foule des montagnards qui avance lentement. On monte sur le plateau de Saint-Restitut, le curé va vers la croix et, de là, bénit la montagne et les fidèles, avant que tout le monde ne reparte vers le village en chantant. Là, l’aubade au Maire est le départ des divertissements : au centre de la place, le mât de cocagne fait la joie des jeunes gens ; entre deux maisons, les uns essayent de renverser une grosse marmite, remplie d’eau, qui se balance grâce à une corde tendue ; d’autres prennent part à la course, dont le départ est donné à la Calade, l’arrivée se situe en haut du champ de Saint-Restitut; puis, il y a la traditionnelle course, les jambes dans un sac, et les trois sauts à Saint-Restitut. Dans le vallon du Grau, il y a le concours de tir au fusil de chasse, sur un grand rond dessiné sur un panneau, qui est posé sur un rocher. Le soir arrive et, sur la place du village, le grand bal commence au son de la viole et à la lumière des lanternes. Tard dans la nuit, les couples de danseurs virevoltent sous les étoiles de Peyresq. Pour Marie et Jean-Baptiste le fils de Jean, jeunes mariés du début de l’été, cette fête est un joyeux prolongement de leurs noces. Elle va durer pendant deux jours encore et il y aura le concours de boules, le concours de chant et le tirage de la grande tombola.
Après la fête, les invités repartent par les chemins vers leurs villages respectifs, prévoyant déjà de se retrouver, avec les Peyrescans, à la fête de Saint-Julien à Thorame, à la fin de ce mois d’août. En attendant, dans chaque village, on se plonge dans l’activité intense des moissons et l’on voit les montagnards travailler dans leurs minuscules parcelles de culture, à la pente des montagnes. Au rythme des faucilles, les meules se dressent sur l’aire du Cros.
Quand le blé sera vanné, on portera le grain au moulin d’Annot, en se rendant à la foire.
Depuis le gros orage de 1868, la meule du moulin de Peyresq n’est plus en état de fonctionner, et le dernier meunier, Elzéard Mayen, ruiné, a quitté le village : sa famille est désormais fixée à Arles et son fils Jean-Baptiste y est devenu instituteur, puis inspecteur de l’enseignement primaire.
Pendant la belle saison, on s’approvisionne de plantes médicinales en prévision de l’hiver, alors que le médecin se trouve souvent dans l’impossibilité de monter à Peyresq, à cause de la route bloquée par la neige. Les Peyrescans ont leurs propres remèdes : au printemps, c’est la cueillette des violettes, dont la tisane soignera les rhumes. En juillet, on fait sécher les fleurs de sureau, pour soigner les yeux. En ces chaudes journées de l’été, on cueille la gentiane, qui servira de purgatif. Enfin, la préparation d’un apéritif, le génépi, qui pousse dans les barres du Coyer et qu’on utilisera pour les maux d’estomac. Pour compléter cette pharmacie populaire, les Peyrescans achèteront à Annot des cataplasmes de farine de lin. Et puis, on immerge des scorpions vivants dans des flacons d’huile pour se guérir des morsures de scorpions, qui sont nombreux à Peyresq. Pour se prévenir des morsures de vipères, un seul remède : porter des chaussures hautes, et marcher avec un bâton à la main pour effrayer celles-ci en faisant du bruit. La lutte contre la maladie prend parfois des aspects étonnants! Lorsque celle-ci débouche, malgré tout, sur la mort, on songe à la santé de l’âme et des messes sont dites à cet effet. Ainsi, en ce jour de la Saint-Barthélémy, le 24 août, les Peyrescans empruntent le chemin royal de Méailles, pour aller assister à la messe dite traditionnellement dans la chapelle St-Barthélemy en cette fin d’été. Celle-ci a été construite il y a plus de deux siècles, en 1677, dans ce quartier de Serre sur la terre de Mathieu Bertrandy. En remontant, après la messe, vers le village, qui se découpe, tout là-haut, sur le ciel bleu sombre balayé d’un vent vif, les Peyrescans songent au bois qu’il va falloir rassembler pour l’hiver : déjà l’air est plus frais et, bientôt, il faudra allumer une petite flambée le soir. Oh! juste une petite flambée, pour économiser le bois précieux! A Peyresq, il n’y en a guère, et il en faut déjà tant pour le four à chaux et pour le four à pain communal. Le mélèze, avec ses qualités de dureté exceptionnelle à cause de sa lenteur de développement surtout à l’ubac de la montagne, décourageant ainsi les insectes xylophages, et le noyer sont réservés pour les bois d’œuvre: gouttières, bardeaux, portes, volets, fenêtres, balcons, mangeoires et barrières. Le buis sert à fabriquer les bâtons de bergers et les clavettes qui ferment le collier des sonnailles, taillé, quant à lui dans le bois de cytise. Pour allumer le feu dans le poêle, on se sert de genêts séchés et des branchettes mortes de mélèze, appelées « pétarello » parce qu’elles crépitent. A la fin de sa journée de travail, le montagnard rapporte toujours un fagot de bois au village, s’il n’est pas déjà encombré d’outils. Du bois, rien ne se perd : la cendre sert à faire la lessive et à conserver les œufs. Le bois est un matériau précieux dans cette région de pierres et l’on se souvient encore à Peyresq du temps où il fallait disputer au Roi de France, qui venait se servir dans ces montagnes pour la construction de bateaux, le peu de bois que pouvaient donner les maigres forêts de la commune.
Quand les bûcherons et les scieurs de long reviennent de la forêt, les femmes leur servent une daube longuement mijotée, pour les réconforter : elles ont acheté un peu de boeuf à la foire d’Annot, après avoir vendu une partie de leur récolte de miel.

Depuis deux ans, on peut se rendre à Annot en chemin de fer : la halte de Peyresq est au fin fond de la vallée de la Vaïre, à une heure et demi de marche du village, à partir de là, le voyage est plus rapide qu’autrefois, non seulement pour les Peyrescans qui se rendent à la foire, mais aussi pour les adolescents qui rejoignent le collège en ce début d’automne, grâce au petit « Train des Pignes » (qu’on appelait ainsi parce qu’on alimentait sa chaudière en pommes de pin – les pignes).
A l’école de Peyresq, les enfants retrouvent leur institutrice. Au moment de la récréation, les voix des jeunes écoliers parviennent aux oreilles de Jean qui garde son troupeau au-dessus du village. Il se souvient du temps où lui-même allait s’asseoir sur les bancs de l’école : de cette époque il ne lui reste que sa pierre gravée de ces signes étranges dont il a appris qu’ils sont grecs. Ce matin, sa bru Marie, est montée au grenier pour y prendre un panier de laine, qui attendait là d’être filée, depuis la tonte du printemps : elle veut commencer à tricoter la layette de son premier bébé, qui va naître bientôt. Jean est heureux en pensant à ce petit (ce sera sûrement un garçon !) qui fera de lui un grand-père, enfin ! Son fils aîné, Firmin, est resté célibataire, le cadet est mort sous une avalanche de neige : seul, le dernier, Jean-Baptiste, pouvait lui donner des petits enfants. Bientôt ce sera accompli. Marie réserve la laine la plus claire pour les mailletons; la laine marron sera pour les chaussettes de son mari.
Pendant que sa femme trie et file la laine, Jean-Baptiste est allé « éclairer » le four à pain. Un roulement pour le chauffage du four communal a été adopté depuis la fin du siècle dernier, afin d’éviter que ce ne soient toujours les mêmes habitants qui s’en chargent.
En ce début d’hiver, les outils des champs sont raccrochés dans la remise : la houe à deux dents, le pic pour les sols pierreux, les faucilles, le râteau, le van sont déjà rangés. Bientôt, la cognée, la hache et la scie de long viennent les rejoindre. Les habitants de Peyresq, peu à peu, reprennent leurs activités et habitudes d’hiver. A la « chambrette » où pendant les veillées, on parle de ceux qui se sont exilés : chaque année, de nouvelles familles quittent le village définitivement, et 1913 ne fera pas figure d’exception dans cet exode irrémédiable. La seule solution que trouvent les Peyrescans, face à leurs nombreuses difficultés de survie dans leurs montagnes, est de répondre à l’appel des villes : Annot, Digne, Aix, Grasse, Nice et surtout Marseille. La vie pour les habitants des hameaux isolés était encore plus rude que pour ceux du village. Ainsi, Firmin, fils d’un habitant du hameau de la Braïsse à une heure et demi de marche de Peyresq, n’avait jamais été à l’école et ne savait ni lire ni écrire.
La neige enveloppe à nouveau le village d’un immense silence blanc. Les hommes ont sorti les raquettes, qu’ils ont confectionnées eux-mêmes avec du bois et de la corde, pour se déplacer. Ils ouvrent d’étroits chemins pour se rendre d’une maison à l’autre et, surtout, de la maison à la fontaine. Pour aider le facteur, les jeunes du village ouvrent la route à la pelle: trois jours de travail pour arriver à la route de la Colle ! Tous les jours, quel que soit le temps, le facteur part à pied de Peyresq jusqu’à la gare de Thorame-Haute : une heure et demi pour descendre par une pente raide. Au retour, il y a une dénivelée de 600 m à remonter, avec, parfois, des colis à transporter. Combien de fois, le facteur a-t-il été obligé de passer la nuit sous un petit pont de la forêt de la Blache, dans un lit de feuilles, parce qu’une tempête de neige l’avait empêché d’atteindre le village !
Noël est revenu, avec, dans les petits souliers des enfants de Peyresq, des oranges et des friandises. La famille partage le souper traditionnel : les raviolis à la courge, nappés d’une sauce aux noix. Pendant ces vacances, les enfants s’en donnent à cœur joie dans la neige et les batailles de boules de neige sont leur occupation favorite.
Mais, peu à peu, la neige se transforme en boue sale qui s’écoule vers les ravins et les torrents bouillonnent d’une eau glacée. Le village sort de son engourdissement hivernal: pendant que les hommes se préparent à retourner aux champs, les femmes s’adonnent à de grosses lessives. Tandis que Marie remonte lentement de la source, avec sa corbeille de linge lavé, elle ressent une violente douleur. Elle sait ce que celle-ci annonce. Elle appelle sa mère, qui va prévenir la sage-femme. La chambre est vite prête, avec les bassines d’eau et les linges propres. Quelques heures plus tard, Joseph, petit-fils de Jean, pousse son premier cri dans la maison, à l’entrée du village. Une semaine plus tard, les cloches de l’église annoncent son baptême. Son père ne cache pas sa joie : Joseph est son premier enfant et un fils qui plus est !
Hélas, cette joie sera de courte durée ! Trois mois s’étaient écoulés, lorsque les cloches de l’église peyrescane se sont unies à celles des vallées et à celles de la France entière pour sonner le tocsin : la grande guerre s’annonçait. Tandis qu’elle va aux champs, en portant son bébé sur le dos, Marie voit son mari partir pour un pays dont il ne reviendra jamais. Il ne sera pas le seul « mort pour la patrie » : Peyresq payera un lourd tribut à la guerre : cinq hommes ne reverront pas leur village. Devoir oblige ! Et le devoir de citoyen patriote est un des traits de caractère des Peyrescans.